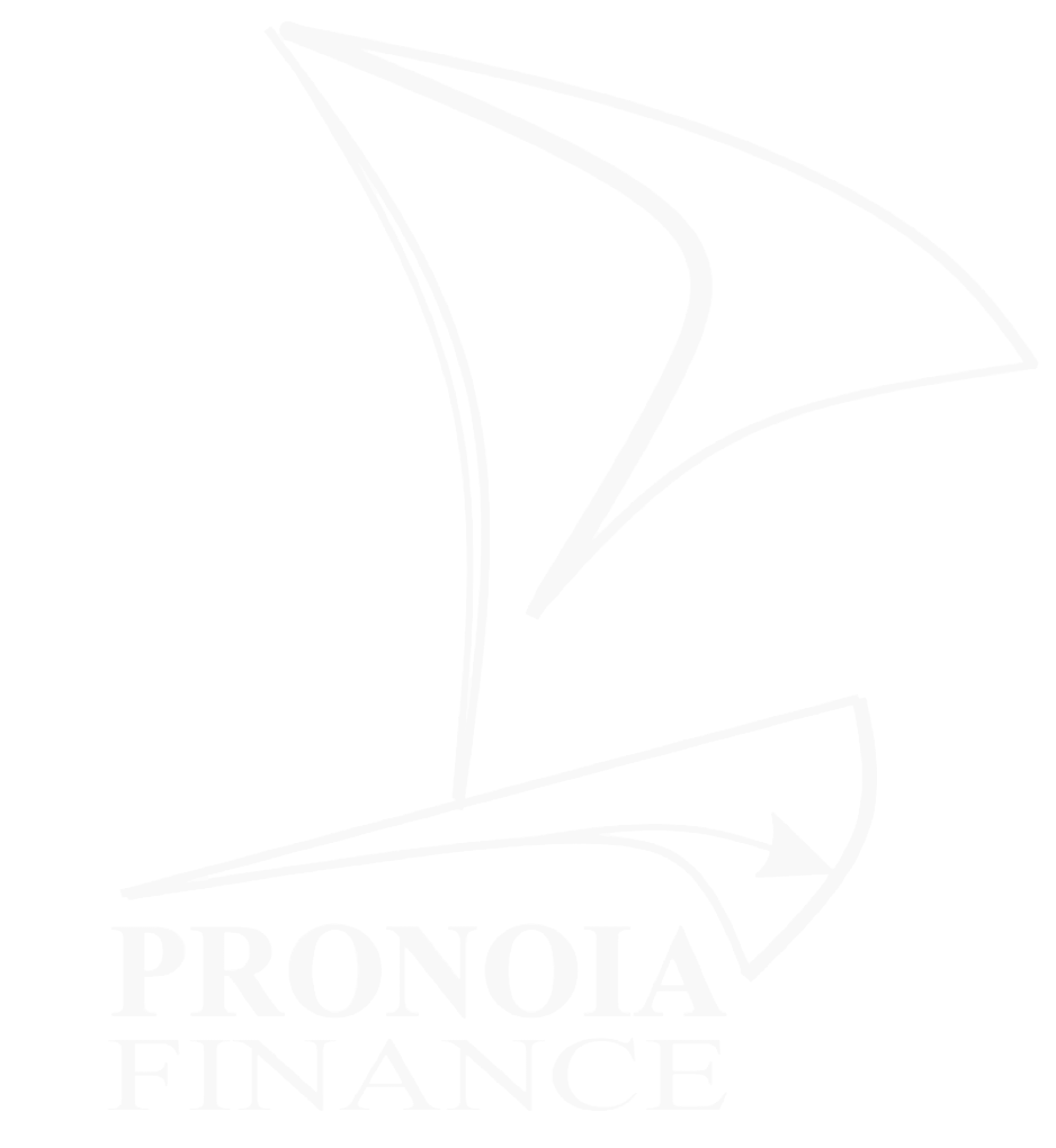Répartition des détenteurs de la dette publique française par secteur à fin mars 2025
Détention des titres de la dette négociable de l’État par groupe de porteurs au 1er trimestre 2025
Compagnies d’assurance française 9,8%, Etablissements de crédit français 9,8%, OPCVM français 1,7%, autres français 24,4%, non-résidents 54,7%.
Source : Banque de France
[Bulletin mensuel de l’Agence France Trésor ]
Détention par les non-résidents des titres de la dette négociable de l’État au 1er trimestre 2025
en % de la dette négociable :
mars 2022 : 48,5%, mars 2023 : 51,4%, mars 2024 : 54,0%, mars 2025 : 54,7%.
source : Banque de France
[Bulletin mensuel de l’Agence France Trésor]
La dette française est détenue à 54,7% par des non-résidents, part qui augmente continuellement.
Comparaison
La part des non-résidents dans la détention de la dette publique est de :
France : 54,7%
Allemagne : 50%
Espagne : 40%
Royaume-Uni : 30%
Italie : 27%
Etats-Unis : 22%
Japon : 10%
Détails sur les non-résidents
Aucune information n’est disponible sur cette détention de la dette publique française par des non-résidents. Ni l’Agence France Trésor, ni la Banque de France, ni le gouvernement ne communiquent ou ne mettent à disposition de données à ce sujet.
Cette absence de communication incite certains à crier au complot. L’Etat français refuserait de jouer la carte de la transparence car il y aurait des détenteurs « peu honorables », ce qui influencerait la politique extérieure de la France.
Et si en réalité il n’était juste pas possible d’effectuer un traçage précis et fiable ?
Explication : des centres offshores apparaissent dans les données. Derrière ceux-ci ne se cache pas un mystérieux conglomérat secret comme le crient certains. Il s’agit en réalité d’intermédiaires financiers et de véhicules juridiques. Dans les bases est enregistré le pays du dépositaire de l’intermédiaire ou du véhicule juridique. Le pays de l’investisseur final ou du bénéficiaire effectif n’est pas enregistré. Ainsi sont sur-représentés dans les données le Luxembourg, l’Irlande, le Royaume-Uni, les Etats-Unis. Par exemple un fonds américain peut acheter des OAT françaises via une société domiciliée au Luxembourg ou aux îles Caïmans. Dans les statistiques la détention sera attribuée à ces derniers même si l’argent provient des Etats-Unis.
Quelle est la nature exacte des investisseurs derrière chaque pays ressortant dans la base ?
Ce que l’on peut dire sans pouvoir être plus précis :
- Pour le Luxembourg et l’Irlande :
des sociétés de gestion d’actifs européennes, des fonds OPCVM, des fonds de pensions, des assureurs.
Pourquoi via le Luxembourg et l’Irlande : fiscalité avantageuse, règlementation UCITS, place de dépôt de titres…
- Pour les Iles Caïmans, les Bermudes :
des hedge funds, des fonds de private equity, des véhicules de titrisation.
Pourquoi via les Iles Caïmans ou les Bermudes : optimisation fiscale, flexibilité juridique, confidentialité…
- Pour Singapour et Hong Kong :
Des banques privées asiatiques, des fonds souverains, des gestionnaires de fortunes. Pourquoi via Singapour et Hong Kong : hub financier régional, accès aux marchés occidentaux…
- Pays-bas :
Des holdings, des fonds d’investissements institutionnels.
Pourquoi via les Pays-Bas : traités fiscaux favorables, hub pour l’Europe…
Les catégories d’investisseurs finaux sont pour la majorité :
- Des banques centrales étrangères (via des véhicules de gestion de réserves domiciliées offshore),
- Des fonds souverains (Moyen-Orient, Asie, Scandinavie),
- Des fonds de pension et des assureurs (Etats-Unis, Canada, Europe…),
- Des hedge funds (souvent domiciliés aux Caïmans ou aux Bermudes),
- Des banques privées gérant des fortunes familiales (« family offices »).
En résumé si 15% de la dette française ressort dans les données détenue au Luxembourg, cela signifie que 15% de la dette est déposée ou structurée via des entités luxembourgeoises dont les bénéficiaires finaux peuvent être japonais, américains, norvégiens,…
- La traçabilité réelle des investisseurs non-résidents est de toute évidence compliquée. Les statistiques brutes sur les centres offshores ne permettent pas de savoir avec certitude qui détient la dette en bout de chaîne.
En quoi est-ce problématique que la dette publique française soit détenue à 54,7% par des non-résidents ?
Car une dégradation de la note publique peut entraîner des ventes massives de cette dette, surtout si la notation change de catégorie.
Explication : les détenteurs considèrent les dettes souveraines comme plus ou moins risquées. Ils définissent une politique d’investissement de leurs actifs compartimentée en différentes catégories de risque, soit statutairement soit règlementairement. Par exemple un assureur encaisse les cotisations des assurés et gère un risque de sinistre. Il va placer les primes encaissées en fonction des taux de sinistres attendus. Il va par exemple définir que 40% des fonds en attente doivent être investis dans une catégorie de haute qualité, 25% dans une catégorie de qualité moyenne,…
Une dégradation de la notation d’une dette publique peut entraîner un changement de catégorie de risque. L’investisseur est contraint d’ajuster ses investissements pour respecter la politique définie. Il va arbitrer la dette publique dégradée au profit d’une autre dette moins risquée.
La vente de la dette dégradée peut être plus ou moins massive en fonction de l’impact sur les politiques d’investissement. Si la vente est massive, il s’ensuit un déséquilibre de l’offre et de la demande de papier et corrélativement une envolée du rendement de la dette dégradée. L’Etat lancera ses nouvelles émissions à des taux plus élevés et paiera une facture d’intérêts plus élevée. Le poids du service de la dette (dépense prioritaire et obligatoire pour ne pas tomber en défaut de paiement) va impliquer des arbitrages budgétaires immédiats.
La détention par des non-résidents est problématique car l’Etat est alors acteur impuissant. En effet si l’Etat français peut agir sur les fonds euros détenus en assurance-vie en bloquant temporairement les retraits (loi Sapin 2), s’il peut mettre une pression ou négocier avec les banques et assurances françaises, il ne peut pas avoir d’impact sur les non-résidents. La BCE pourra accroître sa détention de titres français pour limiter l’envolée. Son impact sera cependant limité : non seulement elle ne peut posséder majoritairement de la dette française (rappelons l’importance de cette dernière, la deuxième en poids en Europe), mais il est probable que les dettes périphériques soient également attaquées au même moment, comme ce fut le cas lors de la crise des dettes souveraines il y a 15 ans.
Une nouvelle dégradation de la note française serait-elle grave ?
La France est actuellement notée AA- par S&P et Fitch. Une dégradation d’un notch la porterait en catégorie A+.
Rassurons nous tout de suite, la dette de la France ne basculerait pas en catégorie High Yield (BB+ à C), elle demeurerait en Investment Grade. Rappelons aussi que le Japon est en catégorie A+, l’Espagne en catégorie A, le Portugal en A-, et l’Italie en BBB+. Vous avez bien lu !! La notation de la France est aujourd’hui meilleure que celle de l’Espagne, du Portugal, et de l’Italie ! A quel titre ? On se le demande. Rien ne le justifie. De toute évidence la notation de la dette française devrait être dégradée depuis bien longtemps vue la trajectoire prise. La dégradation semble inévitable et imminente.
Il est cependant utile de préciser que la catégorie Investment Grade comprend trois sous catégories : les actifs de haute qualité (AAA à AA-) auxquels appartient pour le moment la dette française, les actifs de qualité moyenne supérieure (A+ à A-), les actifs de qualité moyenne inférieure (BBB+ à BBB-).
Depuis la mise en place de l’Euro la dette française a toujours appartenu à la première catégorie. Elle est une dette très recherchée par les investisseurs. Ce qui n’a jamais été le cas des dettes de l’Espagne, du Portugal, et de l’Italie.
Quand on croise le montant de la dette française (3 345,4 Mds€ à la fin du 1er trimestre 2025) et sa trajectoire, la part des non-résidents dans les détenteurs (54,7%) et son évolution, les données sont plus inquiétantes. La dette italienne est certes importante mais la part des non-résidents est de 27%. Idem pour le Japon (non-résidents 10%), et les Etats-Unis (22%). Nous ne cessons de le marteler au travers de nos notes, la France n’a plus les moyens de sa politique. Des arbitrages conséquents s’imposent d’urgence pour inverser la tendance. Est-ce possible ? Théoriquement oui, mais quand on assiste au spectacle lamentable des différents partis politiques, on se le demande.
Conclusion
Une dégradation d’un notch de la notation de la dette française à l’automne peut avoir un effet limité, car c’est une situation de fait avérée depuis plusieurs mois. Mais la situation peut tout aussi bien déraper et devenir incontrôlable. Personne ne peut prédire la réaction des non-résidents. Espérons et, c’est plus que probable, qu’ils ont anticipé la situation. Quoi qu’il en soit, la France doit engager d’urgence des mesures drastiques et normalement tout le monde devrait être d’accord avec cela. Le contraire est nier la réalité. C’est ce qu’attendent avec patience pour le moment les investisseurs, détenteurs de la dette publique française. La patience de chacun a ses limites.