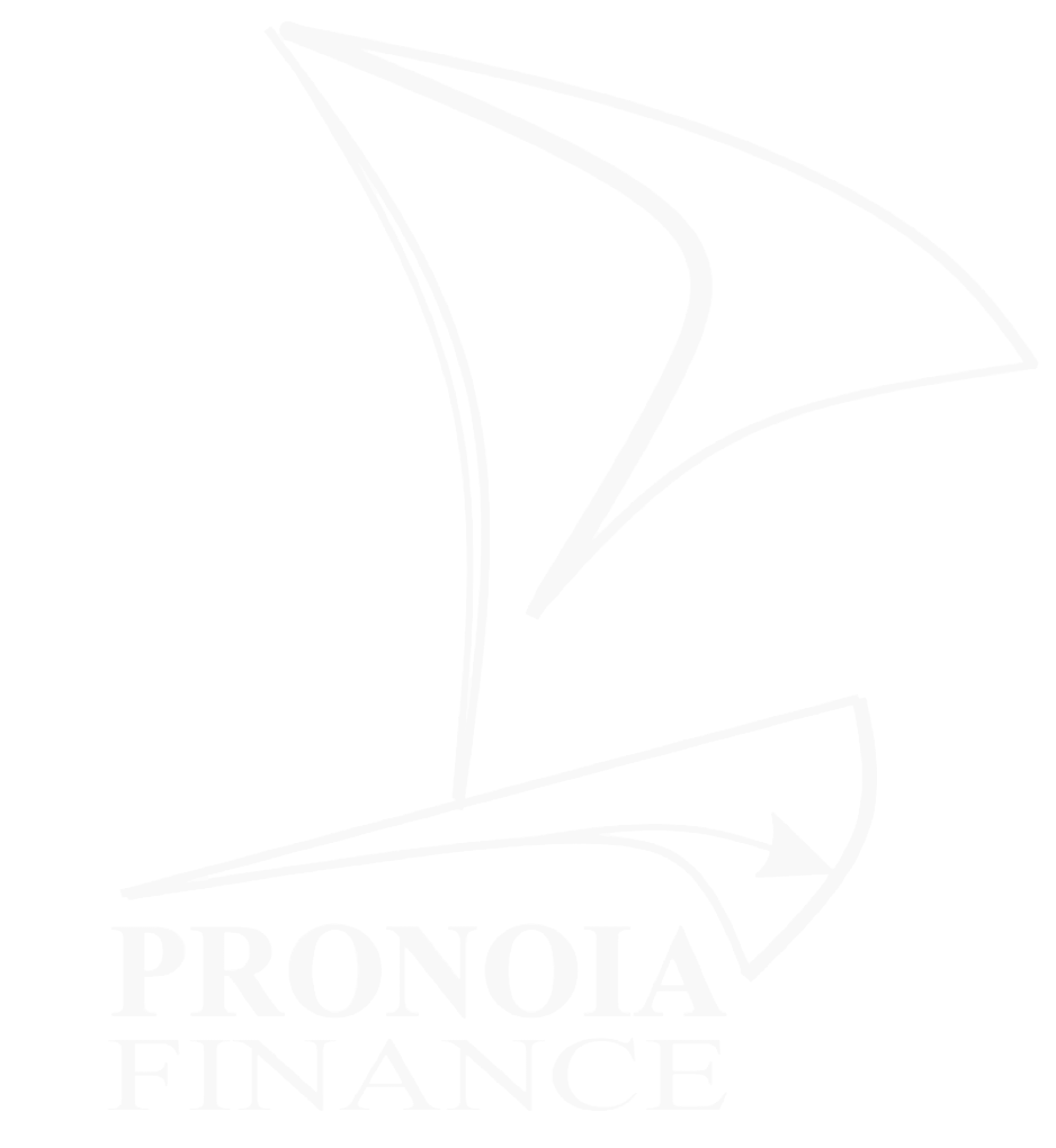La France emprunte plus cher que les principaux pays de la zone Euro
A 5 ans la France est le pays qui emprunte le plus cher parmi les 12 principales économies de la zone Euro.
| 23/07/2025 | 5 ans | 10 ans |
| Allemagne | 2,15% | 2,60% |
| Pays-Bas | 2,25% | 2,77% |
| Autriche | 2,28% | 2,92% |
| Irlande | 2,29% | 2,85% |
| Portugal | 2,32% | 3,03% |
| Slovaquie | 2,36% | 3,42% |
| Finlande | 2,39% | 2,97% |
| Espagne | 2,39% | 3,19% |
| Belgique | 2,43% | 3,14% |
| Grèce | 2,54% | 3,30% |
| Italie | 2,64% | 3,46% |
| France | 2,65% | 3,27% |
Comment la seconde économie de la zone Euro en est arrivée là ?
Une dette publique non maîtrisée qui continue de déraper (cf infra), un pays sous protocole européen depuis le 1er septembre 2024 qui continue malgré tout de ne pas respecter les critères de Maastricht, une incapacité complète du pays à trouver une solution pour endiguer ses déficits publics, un bal musclé des égoïsmes individuels chacun défendant sans limite ses propres intérêts sur fond de cacophonie déconcertante et navrante des divers partis politiques incapables de s’entendre pour la bonne cause…
Les marchés redoutent désormais un rejet du budget de l’Etat français à l’automne. S’en suivrait un vote de censure et une crise politique majeure, mais surtout une dégradation immédiate de la note de la France par les agences de notation.
La cacophonie actuelle semble sans solution et mener directement à cette situation.
De toute évidence le système actuel ne fonctionne pas, ne fonctionne plus. La démagogie l’emporte sur le sens des responsabilités.
Le silence de nos voisins vertueux est étonnant. Préfèrent ils se taire par crainte d’un risque systémique ? C’est probable. La France n’est pas la Grèce. Son économie représente 19% du PIB de la zone Euro. Celle de la Grèce représente moins de 2%. Quand on se remémore la crise des dettes souveraines de la zone Euro qu’avait engendré le défaut de la Grèce en 2010, il est évident qu’une défaillance de la France mettrait à mal la zone Euro. La situation est très grave. Nos voisins sont circonspects. Ils ne comprennent pas l’incapacité de la France à prendre des décisions qui permettraient de redresser la barre. L’attitude de la France est profondément égoïste et irresponsable.
Pourquoi est-il si difficile de trouver une solution ?
Les français tirent la langue et ne sont plus prêts à réaliser de nouveaux sacrifices, le système de santé est au bord de l’explosion, le système éducatif est en grande souffrance, près de 16% des résidences principales sont des logements sociaux et le nombre de foyers en attente de logements sociaux ne cesse de croître, le ressenti des citoyens est une dégradation des services publics…
Le déficit public français s’est établi à 5,8% du PIB en 2024. L’objectif 2025 qui paraît de moins en moins accessible est de ne pas dépasser 5,4%. Les débats actuels portent sur le déficit 2026 que le gouvernement veut réduire à 4,6%. Le retour dans les critères de Maastricht sous les 3% n’est escompté qu’au mieux en 2029. Bien que ces niveaux ne soient déjà pas acceptables en soi, les partis politiques ne parviennent pas à s’entendre pour les respecter. Il est à redouter que l’atterrissage soit plus sévère.
Heureusement une politique monétaire accommodante de la BCE
La BCE a de nouveau réduit ses taux directeurs de 1% depuis le 1er janvier. Son taux de facilité de dépôt est de 2%, son taux principal de refinancement de 2,15%, et son taux d’appels d’offres à taux variable de 2,40%.
De nouvelles baisses sont attendues à l’automne, entre 0,25% et 0,50% supplémentaires.
Cette politique est rendue possible par deux facteurs : une Inflation temporairement maîtrisée bien que demeurant au-dessus de l’objectif de 2% (attention toutefois, cette maîtrise est précaire), et un renchérissement significatif de l’euro face au dollar (15% depuis le 1er janvier). Ce renchérissement est bienvenu. Il permet à la BCE de baisser significativement les taux sans faire courir de risque à la devise. La BCE en profitera sans vergogne si une crise des dettes souveraines devient menaçante à l’automne.
Cette politique monétaire accommodante est une des explications de la bonne tenue des places boursières européennes malgré les menaces décrites précédemment et malgré la guerre commerciale avec les Etats-Unis sur les tarifs douaniers. On peut également noter, même si cela est moins glorieux, que les matières premières et notamment l’or sont recherchés (l’once avoisine les 3 400$), tout comme les actifs antisystèmes (cryptos monnaies et autres supports non régulés qui concentrent tout l’argent sale du monde entier et qui font peser une nouvelle menace sur les économies, les Etats et leurs dettes publiques).
La dette publique française progresse encore et encore
A la fin du 1er trimestre 2025, la dette publique française brute au sens de Maastricht s’établit à 3 345,4 Mds€ (source Insee). Elle a progressé sur un an glissant en montant (+184,6 Mds€) et en représentation du PIB (113,9% contre 110,4%).
Dans les détails l’endettement de l’Etat a de nouveau progressé de 162,5 Mds€ à 2 723 Mds€, celui des organismes d’administration centrale à dette publique a diminué de 3,6 Mds€ à 69,7 Mds€, celui des administrations de sécurité sociale a augmenté de 12,2 Mds€ à 289,9 Mds€.
La dette des administrations publiques locales a progressé de 13,6 Mds€ à 262,5 Mds€.
La dette publique française nette a augmenté de 190,7 Mds€ sur un an glissant à 3 115,4 Mds€.
Dans ces conditions une dégradation de la note de la France par les agences de notation est redoutée à l’automne. Ses effets seraient dévastateurs. La France ne pourrait plus assurer le refinancement de sa dette et serait contrainte de procéder immédiatement à des coupes budgétaires violentes.
La situation des Etats-Unis n’est guère plus réjouissante. Le déficit public a été de 6,4% en 2024. La dette publique atteint 37 000 milliards de dollars, soit un ratio de dette/PIB de 122%. C’est une des principales raisons qui ont poussé le président Trump à augmenter les tarifs douaniers. L’efficacité n’est pas garantie pour autant.
Il est temps de réfléchir au modèle social souhaité pour la France à l’avenir
Le modèle français louable du « tout gratuit ou presque » financé par des charges sociales importantes sur les salaires et une minorité de français (44%) qui paient des impôts ne fonctionne plus. La France n’a plus les moyens de cette politique. Il devient inévitable de tailler dans les dépenses. A moins de revoir complètement le modèle des ressources.
En effet les français, quels qu’ils soient, sont excédés. Les temps sont durs pour tout le monde. Chacun est légitime dans ses revendications. Mais les caisses de l’Etat sont vides.
En parallèle le travail au noir, l’économie de la drogue, la criminalité se développent rapidement. L’explosion du système semble inéluctable.
Il est temps de faire le deuil de notre système passé et de notre modèle social pourtant louable. Autrement c’est tout le pays qui va sombrer dans le chaos et l’avenir sera incertain.
Il est nécessaire que chacun réfléchisse cet été avec réalisme sur le modèle social qu’il souhaite pour l’avenir. Quelles sont les priorités. Quelles sont les concessions inévitables.
Les salaires sont plus élevés chez nos voisins suisses et allemands. Les charges sociales sur le travail sont nettement moindres. En contrepartie peu de services publics sont gratuits.
Faut-il remonter significativement les salaires en diminuant fortement les charges sur ces derniers afin que l’opération soit neutre pour les employeurs ? Ce serait un bon moyen d’éradiquer le travail au noir et de lutter contre le chômage en évitant les arbitrages. Le modèle serait plus proche du modèle des Etats-Unis. L’Etat percevrait davantage de recettes de TVA sur la consommation, percevrait davantage d’impôt sur le revenu sur une base élargie, et dépenserait moins pour financer le chômage. La transition n’est pas simple à mettre en place.
Rappelons que le taux d’épargne des français est parmi les plus élevés du monde. Les français, qui sont déjà les plus gros consommateurs d’anxiolytiques au monde, économisent par peur du lendemain.
Le marché des emprunts pour les entités publiques locales
L’impact de la tension sur les comptes publics est peu visible pour le moment sur les financements des entités publiques.
Les marges de crédit ont pourtant été relevées à la mi-juin par les prêteurs, à la suite de l’échec du conclave sur les retraites, qui a sonné le glas des espoirs sur les déficits publics. Pour les investisseurs la France court à la catastrophe, le risque est donc accru et doit être mieux rémunéré.
Heureusement la baisse des taux directeurs de la BCE et corrélativement des taux courts et des taux longs sont venus compenser cette hausse.
La situation pourrait se compliquer si la remontée des OAT s’accentuait. Le marché obligataire est déjà tendu. Le marché bancaire pourrait être impacté : en effet quel serait l’intérêt d’un investisseur de prêter à un hôpital public français ou à une collectivité territoriale à un niveau inférieur à l’OAT de référence ?
Nous avons noté que, comparé aux années précédentes, davantage de consultations ont été lancées sur le premier semestre, probablement par anticipation d’une situation dégradée.
L’automne s’annonce incertain.