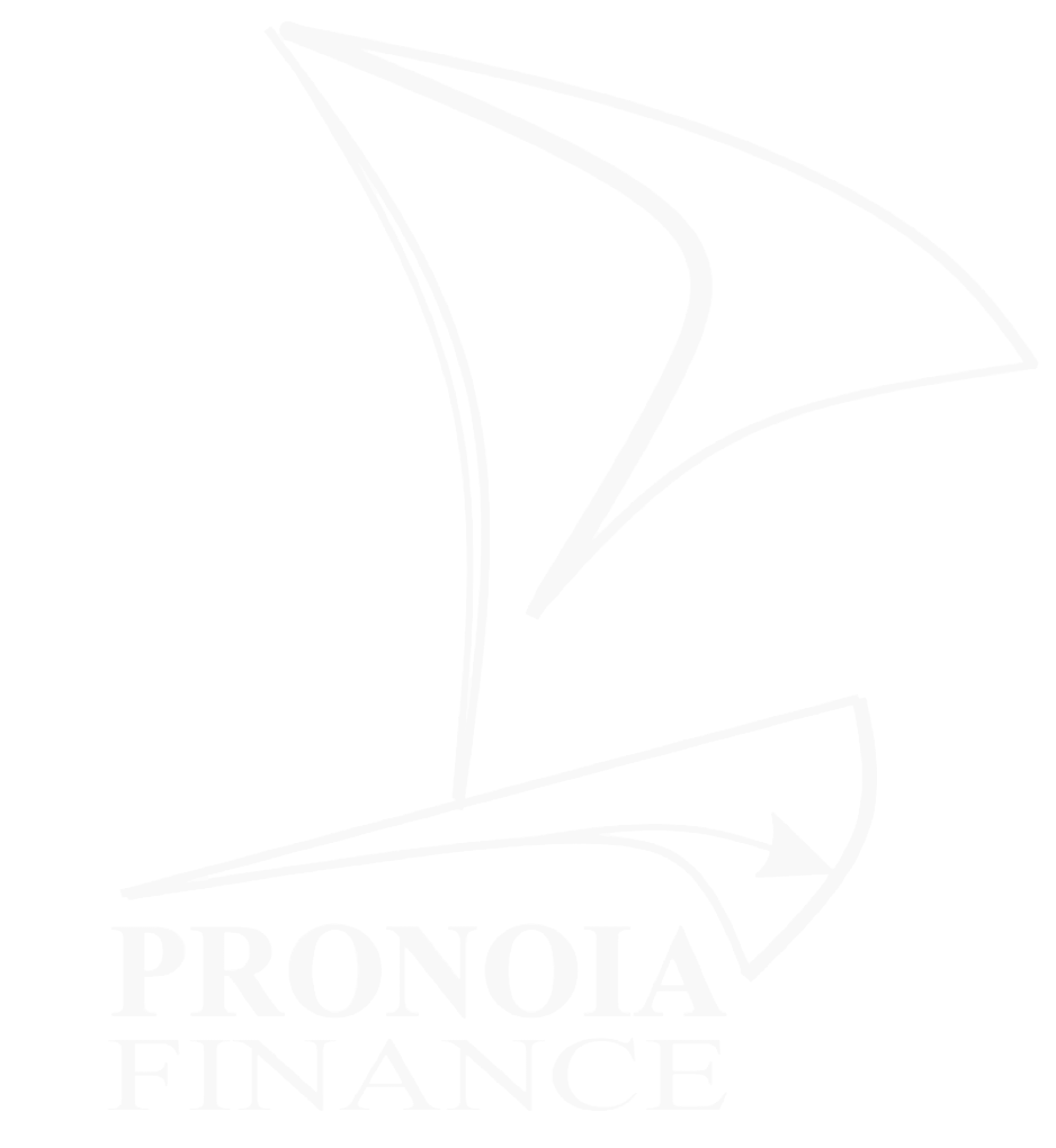Ah que ce serait vertueux ! Une production nationale égale aux recettes, elles-mêmes égales aux dépenses, qui seraient la somme de la consommation et de l’investissement sans recourir aux dépenses publiques.
Nous abordons ici le cas français mais la France n’est pas le seul pays développé à être confronté au casse-tête de cette équation qu’on ne parvient plus à résoudre depuis de nombreuses années.
Une crise sanitaire qui bouleverse l’économie et aussitôt émergent des plans de relance partout dans le monde, des milliards d’euros mobilisés pour tenter de restaurer l’équilibre par la consommation qui se veut être le moteur de la croissance. Comme s’il s’agissait d’un simple choc et que tout allait ensuite finir par rentrer dans l’ordre. Cependant l’Etat français semble avoir bien intégré que cette recette traditionnelle ne fonctionne plus car, contrairement à d’autres pays, il innove avec des solutions mieux adaptées pour combattre le fond du problème.
La crise est en réalité plus structurelle, et la COVID ne fait qu’accélérer une orientation déjà esquissée depuis plusieurs années. Chocs d’offre et de demande se cumulent aujourd’hui, entraînant un ralentissement de la progression effrénée de la consommation, salué par les défenseurs de la planète.
La crise des débouchés économiques a débuté dans les années 70. La mondialisation l’a occultée dans un premier temps en proposant de nouvelles solutions. Le marché mondial n’est aujourd’hui plus suffisant pour absorber la production des produits traditionnels. En découlent pour chaque secteur économique, dans l’ordre :
– un ralentissement de l’investissement qui n’est plus générateur de valeur,
– une préférence pour la croissance externe entraînant une concentration des acteurs,
– un rachat par les entreprises de leurs propres actions, dernière solution pour accroître la rentabilité des fonds propres quand il n’y a plus de projet d’acquisition,
– une réduction drastique des coûts,
– un ajustement de la masse salariale à la première occasion.
Les ralentissements économiques permettent de licencier massivement pour réembaucher ensuite à des salaires inférieurs. C’est un ajustement de l’entreprise à son marché par la base, qui entraîne un appauvrissement des ménages et une moindre capacité à consommer, tirant au final l’économie vers le bas. Les solutions proposées par le gouvernement pour favoriser la prise en charge du chômage partiel sont inédites et intéressantes. Elles freinent le recours aux licenciements massifs que certaines entreprises n’auraient pas manqué de saisir devant une telle opportunité.
Cette orientation concerne les secteurs économiques traditionnels qui ne parviennent pas à se réinventer, au contraire des nouveaux marchés bien entendu. Les marchés boursiers ne s’y trompent pas. Si les principaux indices mondiaux ont retrouvé ou dépassé leurs niveaux d’avant crise sanitaire, la différenciation sectorielle est importante : les valeurs traditionnelles impactées demeurent en fort repli tandis que les valeurs des secteurs d’avenir s’envolent.
La COVID n’est pas responsable de cet ajustement. Elle n’est que l’accélérateur de cette transformation déjà amorcée depuis plusieurs années. Il est illusoire de croire que les entreprises des secteurs traditionnels touchés retrouveront leurs niveaux de croissance d’avant crise. Certaines peut-être mais peu sans révolution technologique. Le vieillissement de la population et les modifications induites sur les besoins de consommation liés aux cycles de vie aggravent encore le phénomène.
Seule une véritable révolution technologique entraînant toute l’économie dans son sillage, et favorisant le plein emploi avec des gains de productivité substantiels pour maintenir des salaires élevés, permettrait de continuer ce schéma classique dans lequel les revenus du travail des ménages suffisent à faire face à leurs dépenses. C’est partiellement le cas avec la révolution digitale, mais ce n’est pas suffisant à ce stade. A défaut cette orientation de l’économie mène à un appauvrissement relatif du pays et des ménages, qu’il devient essentiel de compenser. Le rang de la France ne cesse de reculer au classement mondial des nations les plus riches.
Une solution passe par le développement d’une épargne privée génératrice de valeur. Elle doit concerner tout le monde sinon les disparités ne cesseront de s’accroître, augmentant le risque de conflits sociaux. Cette épargne privée doit assurer des compléments de revenus aux ménages, puis à terme être suffisante pour faire face aux principaux besoins de ces derniers, voir si possible assurer leur autonomie. Cela fait déjà légion aux Etats-Unis si bien qu’un certain nombre d’américains vivent très honorablement de leurs revenus complémentaires. Ce développement des richesses personnelles n’est-il d’ailleurs pas l’aboutissement du capitalisme ? Celui-ci ne prônait il pas une mise en commun de moyens pour créer de la valeur en vue d’une redistribution, permettant à terme, à l’extrême, à l’homme de ne plus travailler et de vivre de ses rentes de capital ? Encore faut-il pour que cette idéologie soit possible, qu’il n’y ait pas de laissés pour compte.
C’est le sens de la loi Pacte qui encourage l’épargne constructive de patrimoine et le développement de richesses personnelles. Elle favorise notamment l’investissement au capital des entreprises, permettant d’associer l’épargnant de façon croissante à leurs résultats et de le réconcilier avec elles. Les entreprises s’assurent ainsi des ressources supplémentaires. Cela renforce le financement domestique dans un marché de capitaux encore trop exposé aux financements étrangers. Cette loi fait la promotion de produits accessibles à tous. Elle incite en particulier au développement d’une épargne retraite complémentaire par capitalisation.
La suppression de l’ISF et l’adoucissement de la fiscalité des revenus du capital à travers l’instauration de la « flat tax » ne sont pas non plus étrangères à cette volonté de promouvoir une épargne privée constructive de patrimoine.
Les Etats-Unis se maintiennent au sommet en partie également pour cette raison, malgré une dette publique abyssale, une balance commerciale déséquilibrée, et quelques économistes qui annoncent à tort son effondrement depuis une trentaine d’années. De fortes richesses privées assurent l’équilibre et contribuent au financement des investissements innovants.
Nous sommes passés dans les années 80 d’économies d’endettement cloisonnées à des économies mondiales de marchés de capitaux. Dans les économies d’endettement, les marchés domestiques suffisaient à assurer l’écoulement de la production. Le système était inflationniste car le crédit était exclusivement bancaire et les banques en fixaient les conditions en fonction de leurs coûts internes. Chacun y trouvait son compte : l’inflation permettait une progression des salaires en valeur absolue ; les syndicats étaient puissants ; deux tiers des bénéfices des entreprises étaient redistribués aux salariés ; les Etats étaient satisfaits de cette redistribution ; au sein de l’entreprise seuls les managers comptaient, les actionnaires ne percevaient qu’un tiers de l’enrichissement. Cela a fonctionné très bien jusqu’aux deux chocs pétroliers. Le système ne pouvait plus tenir ensuite, et a évolué vers un marché où la ressource n’était plus accordée exclusivement par les banques mais de façon croissante par les marchés de capitaux, domestiques d’abord, puis rapidement mondiaux. Le système est ainsi devenu déflationniste et la rémunération de l’actionnaire est devenue une priorité.
Dans ce système nous touchons au but du capitalisme comme évoqué précédemment, mais encore faut-il que les redistributions touchent tout le monde, ce qui n’est pas le cas et accroît les disparités. Les oubliés tombent dans la pauvreté.
Le développement de l’épargne salariale grâce à la participation et à l’intéressement va dans le bon sens. Mais ce n’est pas suffisant car le salarié reste tributaire de sa seule entreprise.
Il est urgent de développer le patrimoine privé, diversifié en ressources et en allocations, seule possibilité pour ne pas induire un appauvrissement, dans un système où les salaires sont mécaniquement amenés à baisser en valeur relative.
Le développement de l’épargne privée peut passer par la constitution de sociétés civiles patrimoniales qui réalisent des investissements diversifiés. Cela se développe déjà fortement pour les investissements immobiliers mais insuffisamment pour les investissements financiers. Les épargnants ont davantage confiance en la pierre que dans les actions, alors que le rendement des actions est nettement supérieur sur long terme. La volatilité à court terme effraie, à tort, car la volatilité à long terme est plus faible. La liquidité est du reste un critère sous-estimé. La dureté de la crise immobilière du début des années 90 semble oubliée. Les actions cotées offrent une bonne liquidité.
Les avantages du développement de l’épargne privée :
Pour l’Etat, bien que ce ne soit pas le but premier, c’est une manne. Elle assure l’équilibre des finances publiques et est une ressource stable, précieuse en période de récession. L’évolution récente de la fiscalité, comme vu précédemment, montre que l’Etat a pris conscience qu’il ne faut pas surfiscaliser cette épargne, mais au contraire soutenir son développement pour accroître la base potentielle de taxations futures. Cette ressource stable et durable permettra à terme de financer les investissements publics sans recourir à l’endettement et de rembourser la dette existante.
Pour les familles, le développement du patrimoine privé peut aussi permettre le recentrage familial. Avec une bonne anticipation par les parents, il offre une solution aux étapes coûteuses de la vie telles que le financement des études supérieures ou la prise en charge de la vulnérabilité. Il permet de diminuer le stress car les prévisions financières sont plus simples à assumer. Organisé sur plusieurs générations, il permet à terme aux plus jeunes de faire davantage le choix d’un métier de passion, moins rémunérateur mais plus épanouissant, car le salaire perçu n’est plus l’unique source de revenus.
Pour les entreprises, l’ajustement de la masse salariale à la réalité de leur dynamique est moins impactant. Elles peuvent ainsi renouer avec une rentabilité solide et durable. Les épargnants investisseurs au capital de ces dernières profitent de la prospérité retrouvée. La richesse globale du pays est au final maintenue et non détruite avec les ajustements à la baisse de la masse salariale. La consommation n’est plus systématiquement amputée par cette dernière, les fruits de l’épargne privée prenant le relais. Les entreprises, fortes d’une compétitivité retrouvée, peuvent davantage exporter et investir à l’étranger, générant ainsi de nouveaux revenus supplémentaires, diversifiés géographiquement et en ligne de métiers. La seule solution à la crise des débouchés pour les entreprises des secteurs les plus touchés est une ouverture à de nouveaux marchés. Ce sera la clé pour sortir du cycle déflationniste et entrer dans un cycle de reflation.
Cet environnement stimule la création d’entreprises et à terme le versement de dividendes, source de recettes fiscales supplémentaires. Le mouvement est déjà enclenché et il faut l’encourager sans le condamner. Il n’y a pas d’autre solution pour éviter la poursuite du recul de la France au classement mondial.
En attendant la déflation est bien installée et les taux courts comme les taux longs vont rester durablement bas. La Banque Centrale Européenne prévoit d’intensifier ses programmes d’achats et d’acquérir bientôt la quasi-totalité des émissions publiques des Etats de la zone euro. En conséquence, les taux des emprunts des entités du secteur public français continueront logiquement à diminuer sous l’effet d’un ajustement du spread au risque estimé.
C’est donc une bonne année qui s’annonce encore pour les emprunteurs publics. La seule ombre au tableau est l’impact de la crise sur la santé des établissements bancaires. Il est difficile d’en mesurer l’étendue à ce jour. On peut estimer qu’elle est cependant limitée pour le moment et qu’elle ne sera pas de nature à provoquer un assèchement du crédit. Il demeure toutefois prudent de continuer à diversifier ses sources de financement en raison du maintien durable de taux négatifs qui pèse lourdement sur la transformation bancaire et érode la rentabilité.
Le maintien des taux directeurs en zone négative et la très forte création monétaire devraient continuer d’entraîner un gonflement du prix des actifs, environnement favorable pour le développement des richesses privées.